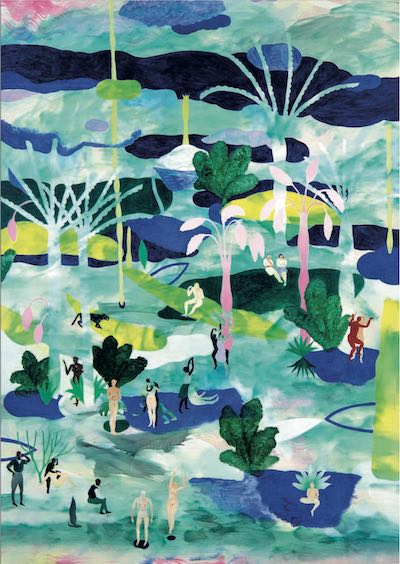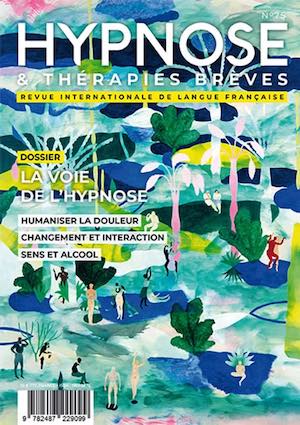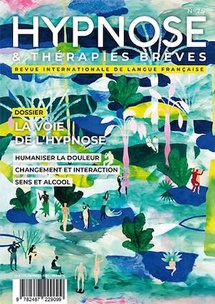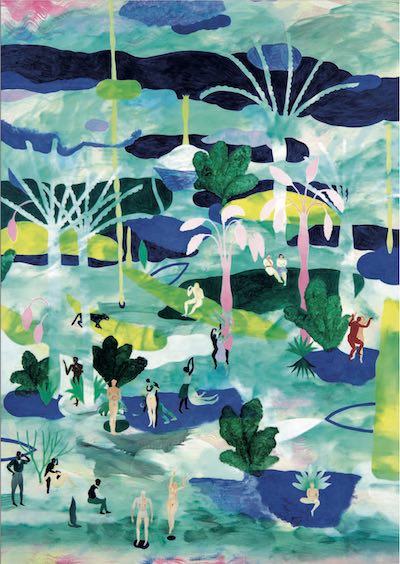
Les métaphores les plus réussies sont celles qui prennent vie d’elles-mêmes. Une métaphore peut se frayer un chemin dans le territoire inconscient d’un auditeur et générer une expérience personnelle. Dans cette histoire, le train a quitté la gare et a continué à rouler (Casula, 2021). La conteuse avait oublié sa métaphore, mais la passagère a poursuivi le voyage vers des territoires et des époques qui lui étaient inconnus. Des années plus tard, une rencontre a à nouveau réuni la conteuse et la voyageuse. La décision des deux auteures de raconter cette histoire est née d’un commentaire d’appréciation d’Evelyne à Roxanna.
C’est avec l’invitation faite à Roxanna de venir parler en Belgique en 2016 que commence cette histoire. Cette excitante opportunité était tout à la fois stimulante et un peu effrayante. Elle impliquait pour Roxanna de voyager seule depuis sa résidence au Texas jusqu’à un pays qu’elle n’avait jamais vu et dont la langue lui était étrangère. L’organisatrice de l’atelier, avec laquelle elle n’avait jamais eu de contact, ne parlait pas l’anglais. Mais ses expériences positives combinant voyage et enseignement ont renforcé la motivation de Roxanna à « sortir de sa zone de confort » et l’ont encouragée à accepter l’invitation. Le fait que les dates coïncident avec son 65e anniversaire l’a fait hésiter.
Mais après réflexion, elle a accepté de venir enseigner en Belgique, prévoyant de fêter cet événement en visitant des sites touristiques une fois le séminaire terminé. Dans le séminaire « Approches ericksoniennes dans le traitement de l’anxiété » étaient combinées des méthodes expérientielles et didactiques. Le cadre ericksonien inclut de mettre l’hypnose, à la fois formelle et informelle, au cœur des approches déve- loppées par Milton Erickson. Elle permet aux individus de s’explorer eux-mêmes à partir d’une nouvelle perspective, en intégrant l’imagerie permissive, l’imagination, les souvenirs, la fantaisie, la vivification de la conscience sensorielle et l’acceptation de l’inconnu (Short, 2017).
Par le biais d’expériences hypnotiques, les sujets puisent dans leurs ressources intérieures qui peuvent alors être utilisées au service des besoins thérapeutiques (Hill et al., 2024). Un hypnothérapeute qualifié peut stimuler cette exploration intérieure par le biais de l’induction formelle d’une transe, ou bien sai- sir les occasions de susciter une expérience de transe naturelle. Evoquer la « sensation » d’un état de transe profonde est une stratégie efficace pour capter l’attention d’un auditoire tout comme pour travailler avec un client en individuel. Proposer une induction de groupe en début d’atelier prépare les participants à développer une compréhension plus profonde du matériel présenté.
Roxanna enseigne un cadre succinct en cinq étapes pour identifier ou susciter un état hypnotique. Ces étapes sont la préparation, la focalisation de l’attention, la déstabilisation, l’exploration intérieure et le retour à l’état d’éveil. Un hypnothérapeute qualifié peut susciter une réponse hypnotique chez un sujet réceptif en l’invitant à porter son attention sur lui-même. Parler avec un rythme doux en utilisant des mots ou des techniques qui éveillent la curiosité de l’auditeur peut provoquer une certaine déstabilisation de la conscience. Ce changement peut susciter en lui une réaction, telle que voir les choses d’un point de vue différent, et peut ainsi l’ouvrir à de nouvelles possibilités. Généralement, c’est lorsqu’il observe cette réponse que l’hypnothérapeute propose, de manière stratégique, des suggestions thérapeutiques pour améliorer le processus de guérison. Les professionnels de l’hypnose sont encore partagés quant à la question de savoir si la transe est avant tout une expérience inter- personnelle (provoquée par un hypnotiste charismatique) ou intrapersonnelle (un état naturel dans lequel les individus glissent au quotidien) (Hill et al., 2024). Selon Roxanna, s’il est guidé efficacement et fait un effort pour coopérer, un sujet peut apprendre à entrer volontairement dans un état hypno- tique. La transition n’est pas sans rappeler les processus d’endormissement et de réveil.
Ces moments de transition entre veille et sommeil impliquent le passage par des phases naturelles appelées hypnagogique (l’état groggy avant le sommeil) ou hypnopompique (le retour à un état de conscience alerte).
En formant d’autres personnes à l’hypnose, le rôle d’un hypnothérapeute expérimenté est de collaborer avec le sujet dans le cadre d’une démarche commune. Une fois l’état hypnotique induit, le sujet apprend, par l’expérience, à reconnaître la transition d’un état de conscience normal à un état de dissociation. A mesure que le sujet apprend à reconnaître les sensations associées à cette transition, elles deviennent plus familières et confortables et rendent la transition plus aisée. Une fois familiarisé avec le sentiment de déstabilisation et la réponse dissociative, un sujet peut apprécier les inductions hypnotiques interpersonnelles ou apprendre à trouver son chemin dans les voyages intrapersonnels d’autohypnose. Cha-un de ces deux modes peut servir à entrer dans l’hypnose dans le but de se comprendre, de se guérir ou d’apprendre à s’apprécier. L’accompagnement par un professionnel de santé qualifié peut s’avérer judicieux selon la nature du travail à effectuer.
POURQUOI UTILISER DES MÉTAPHORES ?
En offrant à l’auditeur des perspectives symboliques ou parallèles à partir desquelles il pourra considérer sa vie, les métaphores l’invitent à voyager dans ses propres repères. Elles suggèrent souvent des idées sur la manière de surmonter des obstacles contre lesquels il a lutté à un niveau conscient. Stratégiquement utilisées, les métaphores peuvent stimuler des associations intérieures qui peuvent ou non avoir un sens à l’état conscient. Quoi qu’il en soit, elles ont le potentiel d’élargir le champ des possibles de manière à faciliter la résolution des problèmes (Casula, 2021).
En hétéro-hypnose, les métaphores sont un moyen efficace de focaliser l’attention du client. Le thème de l’exploration ou la manière dont il est raconté peut capter l’attention de l’auditeur. Les métaphores peuvent contenir des perspectives qui correspondent aux préoccupations de l’auditeur ou qui peuvent être moins évidentes, induisant une recherche profonde. Elles peuvent directement ou indirectement susciter chez l’auditeur des associations qui le feront réfléchir sur lui, voire des doutes et des incertitudes. En faisant surgir des souvenirs ou des perceptions imaginaires qui semblent réelles, elles font appel aux souvenirs, aux émotions, aux espoirs, aux rêves et à la multitude de possibilités inhérentes à la vie de tous les jours. Ces perspectives offrent des horizons plus larges pour résoudre les problèmes ou pour faire le prochain pas en avant (Rosen, 1982). Qu’elles soient spontanées ou planifiées, les métaphores peuvent stimuler de manière stratégique les associations internes.
GÉNÉRER UNE TRANSE DE GROUPE
Bien que cela ne facilite pas la tâche pour l’interprète, Roxanna préfère les inductions improvisées qui évoluent en fonction des réponses des participants. Une transe de groupe doit être suffisamment générale pour captiver la plupart des auditeurs, mais suffisamment spécifique pour favoriser un senti- ment d’individualité. Elle doit être suffisamment souple pour s’adapter à ceux qui sont lents à réagir, tout en restant pertinente pour ceux qui sont plus expérimentés ou plus réceptifs. La relaxation et la paix intérieure sont des objectifs courants pour les formateurs qui proposent une induction de groupe dans le cadre d’un atelier de formation.
Roxanna, quant à elle, aborde la formation différemment. Son objectif est de faire comprendre le potentiel qu’offre l’hypnose tant aux professionnels qu’aux clients individuels. Pour créer un élan dans cette direction, son induction stylisée s’appuie sur des sentiments partagés d’attente, d’anticipation et de désir d’apprendre, ainsi que sur les tensions qui surviennent inévitablement pendant la phase d’inscription à un séminaire. En intégrant ses propres ambivalences et incertitudes, et ses propres efforts pour participer à cet atelier, Roxanna s’est positionnée à un moment que tous les participants présents avaient déjà dépassé. Même si chacun a eu son propre cheminement, le fait évident qu’ils aient eu suffisamment envie de se retrouver dans cette salle la rapprochait des auditeurs. A ce stade de l’induction de groupe, la plupart des participants manifestaient déjà une focalisation de l’attention, une relaxation musculaire, une catalepsie, et au fur et à mesure qu’ils s’absorbaient dans l’expérience, commençaient à réfléchir à leur propre vie. Après qu’elle ait remarqué des signes indicateurs d’une réponse dissociative, Roxanna modifia son discours pour l’orienter sur le processus de transformation, passant du questionnement et des doutes à l’acceptation. Elle établit un parallèle avec sa propre expérience de l’enthousiasme lié à l’exploration d’un territoire au-delà de ce qui est familier.
En se concentrant sur l’espoir et les attentes liés à un développement personnel futur, le continuum du temps, avec le passé, le présent et l’avenir, fut mis au premier plan. L’invitation à la découverte de soi s’est ensuite transformée en métaphore, en l’occurrence celle de l’embarquement à bord d’un train. Bien que le lieu de l’atelier nécessitât d’arriver en voiture, résidents et visiteurs étaient tous familiers du train qui faisait partie intégrante de leur mode de vie. Au-delà de cette familiarité des participants avec ce mode de déplacement, le voyage en train a de multiples attributs qui en faisaient une métaphore d’induction adaptée. En effet, entre les intervalles définis d’embarquement et de débarquement, en tant que passagers, nous nous assoyons confortablement sur un siège que nous avons choisi. Nous sommes libres de nous déplacer, de nous réajuster et de nous repositionner ; nous sommes libres de remarquer et d’observer les scènes à bord du train ou de simplement regarder défiler le paysage ; nous sommes libres d’explorer nos propres émo- tions au fil du temps, ou de nous divertir des scènes extérieures à nous-mêmes.
Pendant que nous sommes engagés dans une combinaison de comportements actifs et passifs, le paysage change et les pensées vagabondent. Nous pouvons nous asseoir face à l’avant ou face à l’arrière, ce qui permet soit de regarder l’avenir approcher, soit de voir le passé défiler derrière nous. Il y a d’autres passagers autour de nous, mais ils sont tous en train de faire leur propre voyage. Les bruits ambiants n’interrompent pas forcément l’expérience intérieure. Le chef de train et les autres agents ont leurs propres tâches à accomplir, alors que les passagers utilisent leur boussole interne pour s’orienter.
Au fur et à mesure que les auditeurs étaient entraînés dans la métaphore, la participation était encouragée par un rythme progressif, étape par étape. Des suggestions furent proposées pour souligner le fait que nous étions là, ensemble, dans le but de développer nos compétences, d’accepter les sentiments d’incertitude et de s’explorer, de réfléchir sur soi et de s’apprécier de manière intentionnelle. Des suggestions post-hypnotiques ont été proposées pour se mettre à l’écoute de son propre processus de croissance, augmenter ses capacités de performance, reconnaître ses réussites, développer des relations avec des collègues partageant les mêmes passions professionnelles et découvrir la satisfaction dans la vie quotidienne. Après environ 25 minutes, l’induction de groupe est arrivée à son terme. Les participants sont descendus de leur train intérieur et se sont réveillés pour se retrouver « ici et maintenant », détendus et rafraîchis. Après une courte pause, Roxanna a invité les participants à faire part au groupe de leurs observations personnelles, en ne prenant la parole que s’ils le souhaitaient. La discussion qui suivit n’eut rien d’exceptionnel.
La plupart des commentaires concernant l’expérience furent très positifs et, comme c’est typique- ment le cas pour les états de transe profonde, de nombreuses personnes déclarèrent qu’elles n’avaient pas le moindre souvenir de ce qui s’était passé. Qu’y avait-il de si remarquable à propos de cet événement ? Près de huit ans plus tard, Evelyne envoya à Roxanna un courriel dans lequel elle écrivait qu’elle avait été tellement inspirée par l’induction de groupe qu’elle avait écrit sa propre version du voyage en train – en français.
C’est avec l’invitation faite à Roxanna de venir parler en Belgique en 2016 que commence cette histoire. Cette excitante opportunité était tout à la fois stimulante et un peu effrayante. Elle impliquait pour Roxanna de voyager seule depuis sa résidence au Texas jusqu’à un pays qu’elle n’avait jamais vu et dont la langue lui était étrangère. L’organisatrice de l’atelier, avec laquelle elle n’avait jamais eu de contact, ne parlait pas l’anglais. Mais ses expériences positives combinant voyage et enseignement ont renforcé la motivation de Roxanna à « sortir de sa zone de confort » et l’ont encouragée à accepter l’invitation. Le fait que les dates coïncident avec son 65e anniversaire l’a fait hésiter.
Mais après réflexion, elle a accepté de venir enseigner en Belgique, prévoyant de fêter cet événement en visitant des sites touristiques une fois le séminaire terminé. Dans le séminaire « Approches ericksoniennes dans le traitement de l’anxiété » étaient combinées des méthodes expérientielles et didactiques. Le cadre ericksonien inclut de mettre l’hypnose, à la fois formelle et informelle, au cœur des approches déve- loppées par Milton Erickson. Elle permet aux individus de s’explorer eux-mêmes à partir d’une nouvelle perspective, en intégrant l’imagerie permissive, l’imagination, les souvenirs, la fantaisie, la vivification de la conscience sensorielle et l’acceptation de l’inconnu (Short, 2017).
Par le biais d’expériences hypnotiques, les sujets puisent dans leurs ressources intérieures qui peuvent alors être utilisées au service des besoins thérapeutiques (Hill et al., 2024). Un hypnothérapeute qualifié peut stimuler cette exploration intérieure par le biais de l’induction formelle d’une transe, ou bien sai- sir les occasions de susciter une expérience de transe naturelle. Evoquer la « sensation » d’un état de transe profonde est une stratégie efficace pour capter l’attention d’un auditoire tout comme pour travailler avec un client en individuel. Proposer une induction de groupe en début d’atelier prépare les participants à développer une compréhension plus profonde du matériel présenté.
Roxanna enseigne un cadre succinct en cinq étapes pour identifier ou susciter un état hypnotique. Ces étapes sont la préparation, la focalisation de l’attention, la déstabilisation, l’exploration intérieure et le retour à l’état d’éveil. Un hypnothérapeute qualifié peut susciter une réponse hypnotique chez un sujet réceptif en l’invitant à porter son attention sur lui-même. Parler avec un rythme doux en utilisant des mots ou des techniques qui éveillent la curiosité de l’auditeur peut provoquer une certaine déstabilisation de la conscience. Ce changement peut susciter en lui une réaction, telle que voir les choses d’un point de vue différent, et peut ainsi l’ouvrir à de nouvelles possibilités. Généralement, c’est lorsqu’il observe cette réponse que l’hypnothérapeute propose, de manière stratégique, des suggestions thérapeutiques pour améliorer le processus de guérison. Les professionnels de l’hypnose sont encore partagés quant à la question de savoir si la transe est avant tout une expérience inter- personnelle (provoquée par un hypnotiste charismatique) ou intrapersonnelle (un état naturel dans lequel les individus glissent au quotidien) (Hill et al., 2024). Selon Roxanna, s’il est guidé efficacement et fait un effort pour coopérer, un sujet peut apprendre à entrer volontairement dans un état hypno- tique. La transition n’est pas sans rappeler les processus d’endormissement et de réveil.
Ces moments de transition entre veille et sommeil impliquent le passage par des phases naturelles appelées hypnagogique (l’état groggy avant le sommeil) ou hypnopompique (le retour à un état de conscience alerte).
En formant d’autres personnes à l’hypnose, le rôle d’un hypnothérapeute expérimenté est de collaborer avec le sujet dans le cadre d’une démarche commune. Une fois l’état hypnotique induit, le sujet apprend, par l’expérience, à reconnaître la transition d’un état de conscience normal à un état de dissociation. A mesure que le sujet apprend à reconnaître les sensations associées à cette transition, elles deviennent plus familières et confortables et rendent la transition plus aisée. Une fois familiarisé avec le sentiment de déstabilisation et la réponse dissociative, un sujet peut apprécier les inductions hypnotiques interpersonnelles ou apprendre à trouver son chemin dans les voyages intrapersonnels d’autohypnose. Cha-un de ces deux modes peut servir à entrer dans l’hypnose dans le but de se comprendre, de se guérir ou d’apprendre à s’apprécier. L’accompagnement par un professionnel de santé qualifié peut s’avérer judicieux selon la nature du travail à effectuer.
POURQUOI UTILISER DES MÉTAPHORES ?
En offrant à l’auditeur des perspectives symboliques ou parallèles à partir desquelles il pourra considérer sa vie, les métaphores l’invitent à voyager dans ses propres repères. Elles suggèrent souvent des idées sur la manière de surmonter des obstacles contre lesquels il a lutté à un niveau conscient. Stratégiquement utilisées, les métaphores peuvent stimuler des associations intérieures qui peuvent ou non avoir un sens à l’état conscient. Quoi qu’il en soit, elles ont le potentiel d’élargir le champ des possibles de manière à faciliter la résolution des problèmes (Casula, 2021).
En hétéro-hypnose, les métaphores sont un moyen efficace de focaliser l’attention du client. Le thème de l’exploration ou la manière dont il est raconté peut capter l’attention de l’auditeur. Les métaphores peuvent contenir des perspectives qui correspondent aux préoccupations de l’auditeur ou qui peuvent être moins évidentes, induisant une recherche profonde. Elles peuvent directement ou indirectement susciter chez l’auditeur des associations qui le feront réfléchir sur lui, voire des doutes et des incertitudes. En faisant surgir des souvenirs ou des perceptions imaginaires qui semblent réelles, elles font appel aux souvenirs, aux émotions, aux espoirs, aux rêves et à la multitude de possibilités inhérentes à la vie de tous les jours. Ces perspectives offrent des horizons plus larges pour résoudre les problèmes ou pour faire le prochain pas en avant (Rosen, 1982). Qu’elles soient spontanées ou planifiées, les métaphores peuvent stimuler de manière stratégique les associations internes.
GÉNÉRER UNE TRANSE DE GROUPE
Bien que cela ne facilite pas la tâche pour l’interprète, Roxanna préfère les inductions improvisées qui évoluent en fonction des réponses des participants. Une transe de groupe doit être suffisamment générale pour captiver la plupart des auditeurs, mais suffisamment spécifique pour favoriser un senti- ment d’individualité. Elle doit être suffisamment souple pour s’adapter à ceux qui sont lents à réagir, tout en restant pertinente pour ceux qui sont plus expérimentés ou plus réceptifs. La relaxation et la paix intérieure sont des objectifs courants pour les formateurs qui proposent une induction de groupe dans le cadre d’un atelier de formation.
Roxanna, quant à elle, aborde la formation différemment. Son objectif est de faire comprendre le potentiel qu’offre l’hypnose tant aux professionnels qu’aux clients individuels. Pour créer un élan dans cette direction, son induction stylisée s’appuie sur des sentiments partagés d’attente, d’anticipation et de désir d’apprendre, ainsi que sur les tensions qui surviennent inévitablement pendant la phase d’inscription à un séminaire. En intégrant ses propres ambivalences et incertitudes, et ses propres efforts pour participer à cet atelier, Roxanna s’est positionnée à un moment que tous les participants présents avaient déjà dépassé. Même si chacun a eu son propre cheminement, le fait évident qu’ils aient eu suffisamment envie de se retrouver dans cette salle la rapprochait des auditeurs. A ce stade de l’induction de groupe, la plupart des participants manifestaient déjà une focalisation de l’attention, une relaxation musculaire, une catalepsie, et au fur et à mesure qu’ils s’absorbaient dans l’expérience, commençaient à réfléchir à leur propre vie. Après qu’elle ait remarqué des signes indicateurs d’une réponse dissociative, Roxanna modifia son discours pour l’orienter sur le processus de transformation, passant du questionnement et des doutes à l’acceptation. Elle établit un parallèle avec sa propre expérience de l’enthousiasme lié à l’exploration d’un territoire au-delà de ce qui est familier.
En se concentrant sur l’espoir et les attentes liés à un développement personnel futur, le continuum du temps, avec le passé, le présent et l’avenir, fut mis au premier plan. L’invitation à la découverte de soi s’est ensuite transformée en métaphore, en l’occurrence celle de l’embarquement à bord d’un train. Bien que le lieu de l’atelier nécessitât d’arriver en voiture, résidents et visiteurs étaient tous familiers du train qui faisait partie intégrante de leur mode de vie. Au-delà de cette familiarité des participants avec ce mode de déplacement, le voyage en train a de multiples attributs qui en faisaient une métaphore d’induction adaptée. En effet, entre les intervalles définis d’embarquement et de débarquement, en tant que passagers, nous nous assoyons confortablement sur un siège que nous avons choisi. Nous sommes libres de nous déplacer, de nous réajuster et de nous repositionner ; nous sommes libres de remarquer et d’observer les scènes à bord du train ou de simplement regarder défiler le paysage ; nous sommes libres d’explorer nos propres émo- tions au fil du temps, ou de nous divertir des scènes extérieures à nous-mêmes.
Pendant que nous sommes engagés dans une combinaison de comportements actifs et passifs, le paysage change et les pensées vagabondent. Nous pouvons nous asseoir face à l’avant ou face à l’arrière, ce qui permet soit de regarder l’avenir approcher, soit de voir le passé défiler derrière nous. Il y a d’autres passagers autour de nous, mais ils sont tous en train de faire leur propre voyage. Les bruits ambiants n’interrompent pas forcément l’expérience intérieure. Le chef de train et les autres agents ont leurs propres tâches à accomplir, alors que les passagers utilisent leur boussole interne pour s’orienter.
Au fur et à mesure que les auditeurs étaient entraînés dans la métaphore, la participation était encouragée par un rythme progressif, étape par étape. Des suggestions furent proposées pour souligner le fait que nous étions là, ensemble, dans le but de développer nos compétences, d’accepter les sentiments d’incertitude et de s’explorer, de réfléchir sur soi et de s’apprécier de manière intentionnelle. Des suggestions post-hypnotiques ont été proposées pour se mettre à l’écoute de son propre processus de croissance, augmenter ses capacités de performance, reconnaître ses réussites, développer des relations avec des collègues partageant les mêmes passions professionnelles et découvrir la satisfaction dans la vie quotidienne. Après environ 25 minutes, l’induction de groupe est arrivée à son terme. Les participants sont descendus de leur train intérieur et se sont réveillés pour se retrouver « ici et maintenant », détendus et rafraîchis. Après une courte pause, Roxanna a invité les participants à faire part au groupe de leurs observations personnelles, en ne prenant la parole que s’ils le souhaitaient. La discussion qui suivit n’eut rien d’exceptionnel.
La plupart des commentaires concernant l’expérience furent très positifs et, comme c’est typique- ment le cas pour les états de transe profonde, de nombreuses personnes déclarèrent qu’elles n’avaient pas le moindre souvenir de ce qui s’était passé. Qu’y avait-il de si remarquable à propos de cet événement ? Près de huit ans plus tard, Evelyne envoya à Roxanna un courriel dans lequel elle écrivait qu’elle avait été tellement inspirée par l’induction de groupe qu’elle avait écrit sa propre version du voyage en train – en français.
UN NOUVEL HORIZON
Alors que Roxanna raconte son voyage en train, Evelyne se laisse bercer par les mots. Son esprit vagabonde au gré des paysages qui défilent derrière la vitre du wagon, libéré des contraintes matérielles. Elle est transportée hors du présent, dans un voyage personnel et introspectif. La métaphore prend un sens immédiat cohérent. En combinant des objets, des êtres, des situations et des événements, le récit développe une intrigue directement saisissable, mais ces éléments cachent aussi un second sens, étranger au premier. Evelyne, l’auditrice, est ainsi mobilisée d’une part par la fiction, d’autre part par un message caché. Elle reconnaît que ce que Roxanna évoque dans ce voyage en train « ressemble » à l’un des aspects de sa vie. En hypnose, la présence sous-jacente d’éléments personnels affecte inévitablement la façon dont le message de l’histoire se décode.
Elle façonne même le contenu du récit en définissant le sens dans lequel il est « élucidé ». Les images émergentes « contaminent » ainsi les éléments narrés, sur lesquels se superposent les significations propres au sujet. Même si les récits thérapeutiques contiennent de multiples significations potentielles, ils ne prennent leur valeur et leur sens que dans un contexte donné. C’est le « hors-champ » de l’histoire qui détermine son interprétation. Comme chacun juge une situation selon son propre point de vue, c’est dans les limites de l’expérience de l’auditeur que s’ouvrent les horizons du sens. Ce n’est donc pas un hasard si Evelyne a exploré ce voyage en train comme une métaphore de la vie et de la mort. Elle pré- parait alors un séminaire sur l’hypnose dans le traitement du deuil, qu’elle animerait pour la première fois quelques mois plus tard. Les êtres humains tentent constamment de donner un sens à leur vie et au monde qui les entoure. Face à une analogie, l’auditeur cherche consciemment ou inconsciemment à établir des corrélations cohérentes entre le discours actualisé (c’est-à-dire l’histoire racontée) et le discours figuré (le message caché faisant référence à un aspect de sa vie). Il est ainsi amené à « arranger » des corrélations entre les nouvelles données suggérées par le récit thérapeutique et certains aspects de sa situation actuelle. L’auditeur construit une image dans son propre contexte de vie et l’image, à son tour, construit l’auditeur.
LE TRAIN DE LA VIE
Pour lire la suite...
Alors que Roxanna raconte son voyage en train, Evelyne se laisse bercer par les mots. Son esprit vagabonde au gré des paysages qui défilent derrière la vitre du wagon, libéré des contraintes matérielles. Elle est transportée hors du présent, dans un voyage personnel et introspectif. La métaphore prend un sens immédiat cohérent. En combinant des objets, des êtres, des situations et des événements, le récit développe une intrigue directement saisissable, mais ces éléments cachent aussi un second sens, étranger au premier. Evelyne, l’auditrice, est ainsi mobilisée d’une part par la fiction, d’autre part par un message caché. Elle reconnaît que ce que Roxanna évoque dans ce voyage en train « ressemble » à l’un des aspects de sa vie. En hypnose, la présence sous-jacente d’éléments personnels affecte inévitablement la façon dont le message de l’histoire se décode.
Elle façonne même le contenu du récit en définissant le sens dans lequel il est « élucidé ». Les images émergentes « contaminent » ainsi les éléments narrés, sur lesquels se superposent les significations propres au sujet. Même si les récits thérapeutiques contiennent de multiples significations potentielles, ils ne prennent leur valeur et leur sens que dans un contexte donné. C’est le « hors-champ » de l’histoire qui détermine son interprétation. Comme chacun juge une situation selon son propre point de vue, c’est dans les limites de l’expérience de l’auditeur que s’ouvrent les horizons du sens. Ce n’est donc pas un hasard si Evelyne a exploré ce voyage en train comme une métaphore de la vie et de la mort. Elle pré- parait alors un séminaire sur l’hypnose dans le traitement du deuil, qu’elle animerait pour la première fois quelques mois plus tard. Les êtres humains tentent constamment de donner un sens à leur vie et au monde qui les entoure. Face à une analogie, l’auditeur cherche consciemment ou inconsciemment à établir des corrélations cohérentes entre le discours actualisé (c’est-à-dire l’histoire racontée) et le discours figuré (le message caché faisant référence à un aspect de sa vie). Il est ainsi amené à « arranger » des corrélations entre les nouvelles données suggérées par le récit thérapeutique et certains aspects de sa situation actuelle. L’auditeur construit une image dans son propre contexte de vie et l’image, à son tour, construit l’auditeur.
LE TRAIN DE LA VIE
Pour lire la suite...
Evelyne Josse
Psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l’université de Metz (UL) et chargée de cours en formation continue à l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Elle a fondé le DIU en hypnose à l’ULB et à l’UL. Elle enseigne l’hypnose aux professionnels de la santé et dispense des cours en psychotraumatologie. Auteure d’ouvrages sur le traumatisme psychique et sur l’hypnose. Elle gère le site www.resilience-psy.com et la chaîne YouTube Resilience Psy. evelynejosse@gmail.com
Roxanna Erickson-Klein
Phd, réside à Dallas (Texas, USA) avec Alan, son mari depuis cinquante ans. Elle est la septième des huit enfants de Milton et Elizabeth Erickson. L’apprentissage de l’hypnose dans sa famille dès le plus jeune âge l’a conduite à explorer ce domaine, à se former, puis à enseigner au niveau national et international. Elle a écrit de nombreux articles et chapitres de livres. Elle est membre du conseil d’administration de la Fondation Milton Erickson à Phoenix, en Arizona. Actuellement, elle continue à enseigner l’hypnose, à conseiller les patients et à écrire, et effectue la numérisation des « Collected Works of Milton H. Erickson MD ».
Commandez la Revue Hypnose & Thérapies brèves n°75 version Papier
N°75 : Nov. / Déc. 2024 / Janv. 2025
Les interactions pour favoriser un changement
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce n°75 :
Si l’hypnose ericksonienne est une hypnose relationnelle, cela implique que le lieu d’habitation du corps soit la relation. Ainsi, lorsque la relation est vivante, le sujet vit une expérience corporelle où spontanément il accueille ses ressentis sensoriels, est en capacité de prendre des initiatives. En ce sens, le travail sur les interactions est primordial pour favoriser un changement.
. Guillaume Delannoy, dans un article très pédagogique, nous montre à partir de quatre situations cliniques – douleur psychosomatique, jalousie entre sœurs, obésité morbide, angoisse de mort et tics nerveux – comment la modification des interactions permet l’activation des processus de réassociation. L’auteur, avec la participation de Vania Torres-Lacaze, souligne l’importance du travail de co-thérapie pour rendre possible le changement.
. Delphine Le Gris nous raconte l’histoire de Sophie dont la vie est parcourue de relations insécures et qui cherche une solution à son problème d’insomnie. Elle nous décrit une séance d’hypnose avec un coffre-fort fermé à clé qui va lui permettre d’y enfermer ses ruminations et de retrouver un sentiment de protection.L’importance de l’humour est au centre du texte de Solen Chezalviel, dont la créativité ouvre une petite lumière dans un monde empli de noirceur.
. David Vergriete, avec sa grande expérience de prise en charge des addictions, évoque, à travers le cas de Guillaume souffrant d’alcoolisme chronique, l’importance de la qualité relationnelle et la nécessité d’interroger la question du sens et de la trajectoire existentielle.
Dans l’espace ''Douleur Douceur'', Fabrice Lakdja et Gérard Ostermann nous parlent de la remédiation antalgique. Le retraitement de la douleur vise à réattribuer la douleur à des voies cérébrales réversibles et non dangereuses et à considérer la douleur comme une fausse alarme et non comme la signature de lésions tissulaires.
. Maryne Durieupeyroux nous emmène à la rencontre de Pablo, jeune homme pris en charge en soins palliatifs pour des métastases multiples. Elle utilise le ''gant magique'' et évalue les réactions du patient au fur et à mesure de son travail.
. Charles Joussellin et Gérard Ostermann : Accueillir, écouter et favoriser un effort de narration doivent être au centre de nos prises en charge. La question du sens, de l’anthropologie, sont indispensables à nos métiers de thérapeutes.
. A partir d’un atelier avec Roxanna Erickson-Klein, Evelyne Josse montre l’importance des métaphores pour focaliser l’attention du patient et remettre la vie des sujets en mouvement. Roxanna utilise la métaphore de l’embarquement à bord d’un train pendant qu’Evelyne se laisse bercer par les mots et, dans cet état de transe, développe sa créativité. Les métaphores nous incitent ainsi à reconsidérer, réélaborer et réévaluer nos expériences en ouvrant de nouvelles possibilités pour redevenir auteurs de nos vies.
. Jean-Marc Benhaiem nous décrit la manière dont il comprend la logique de l’intervention en hypnose. Il nous parle des trois modes d’être : mental, sensoriel et confusionnel. Le déséquilibre entre ces modes s’installe au sein des relations dysfonctionnelles, lorsque le sujet, pour se défendre, privilégie un mode au détriment des deux autres. A travers plusieurs situations cliniques, il fait le lien entre l’excès du mental et le contrôle excessif. Pour le thérapeute, il s’agit d’aider le patient à passer de la rigidité à la fluidité, en retrouvant un corps présent.
Les rubriques :
. Sophie Cohen : Christelle et la trichotillomanie en question
. Adrian Chaboche : La présence
. Stefano Colombo et Muhuc : Voyage
. Psychotrauma, PTR, EMDR
. Sylvie Le Pelletier-Beaufond : Le souffle de la guérison au Népal
Les interactions pour favoriser un changement
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce n°75 :
Si l’hypnose ericksonienne est une hypnose relationnelle, cela implique que le lieu d’habitation du corps soit la relation. Ainsi, lorsque la relation est vivante, le sujet vit une expérience corporelle où spontanément il accueille ses ressentis sensoriels, est en capacité de prendre des initiatives. En ce sens, le travail sur les interactions est primordial pour favoriser un changement.
. Guillaume Delannoy, dans un article très pédagogique, nous montre à partir de quatre situations cliniques – douleur psychosomatique, jalousie entre sœurs, obésité morbide, angoisse de mort et tics nerveux – comment la modification des interactions permet l’activation des processus de réassociation. L’auteur, avec la participation de Vania Torres-Lacaze, souligne l’importance du travail de co-thérapie pour rendre possible le changement.
. Delphine Le Gris nous raconte l’histoire de Sophie dont la vie est parcourue de relations insécures et qui cherche une solution à son problème d’insomnie. Elle nous décrit une séance d’hypnose avec un coffre-fort fermé à clé qui va lui permettre d’y enfermer ses ruminations et de retrouver un sentiment de protection.L’importance de l’humour est au centre du texte de Solen Chezalviel, dont la créativité ouvre une petite lumière dans un monde empli de noirceur.
. David Vergriete, avec sa grande expérience de prise en charge des addictions, évoque, à travers le cas de Guillaume souffrant d’alcoolisme chronique, l’importance de la qualité relationnelle et la nécessité d’interroger la question du sens et de la trajectoire existentielle.
Dans l’espace ''Douleur Douceur'', Fabrice Lakdja et Gérard Ostermann nous parlent de la remédiation antalgique. Le retraitement de la douleur vise à réattribuer la douleur à des voies cérébrales réversibles et non dangereuses et à considérer la douleur comme une fausse alarme et non comme la signature de lésions tissulaires.
. Maryne Durieupeyroux nous emmène à la rencontre de Pablo, jeune homme pris en charge en soins palliatifs pour des métastases multiples. Elle utilise le ''gant magique'' et évalue les réactions du patient au fur et à mesure de son travail.
. Charles Joussellin et Gérard Ostermann : Accueillir, écouter et favoriser un effort de narration doivent être au centre de nos prises en charge. La question du sens, de l’anthropologie, sont indispensables à nos métiers de thérapeutes.
. A partir d’un atelier avec Roxanna Erickson-Klein, Evelyne Josse montre l’importance des métaphores pour focaliser l’attention du patient et remettre la vie des sujets en mouvement. Roxanna utilise la métaphore de l’embarquement à bord d’un train pendant qu’Evelyne se laisse bercer par les mots et, dans cet état de transe, développe sa créativité. Les métaphores nous incitent ainsi à reconsidérer, réélaborer et réévaluer nos expériences en ouvrant de nouvelles possibilités pour redevenir auteurs de nos vies.
. Jean-Marc Benhaiem nous décrit la manière dont il comprend la logique de l’intervention en hypnose. Il nous parle des trois modes d’être : mental, sensoriel et confusionnel. Le déséquilibre entre ces modes s’installe au sein des relations dysfonctionnelles, lorsque le sujet, pour se défendre, privilégie un mode au détriment des deux autres. A travers plusieurs situations cliniques, il fait le lien entre l’excès du mental et le contrôle excessif. Pour le thérapeute, il s’agit d’aider le patient à passer de la rigidité à la fluidité, en retrouvant un corps présent.
Les rubriques :
. Sophie Cohen : Christelle et la trichotillomanie en question
. Adrian Chaboche : La présence
. Stefano Colombo et Muhuc : Voyage
. Psychotrauma, PTR, EMDR
. Sylvie Le Pelletier-Beaufond : Le souffle de la guérison au Népal
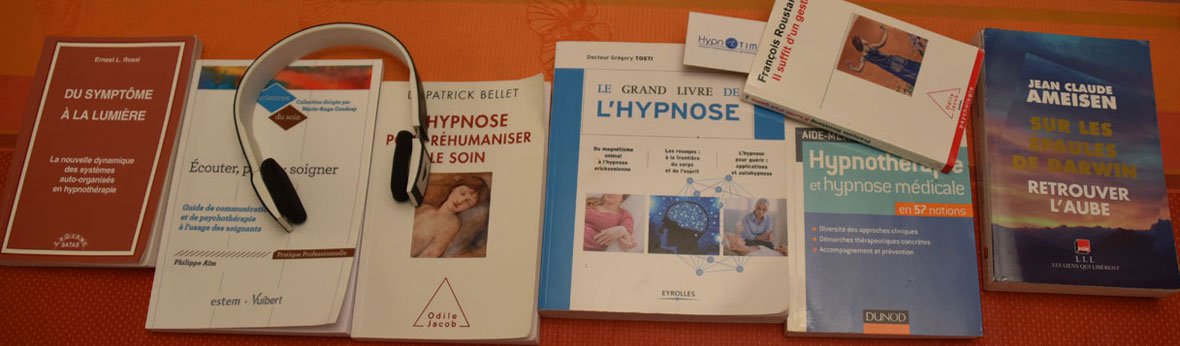
 La prochaine station de train. Déconstruction d'une métaphore hypnotique.
La prochaine station de train. Déconstruction d'une métaphore hypnotique.